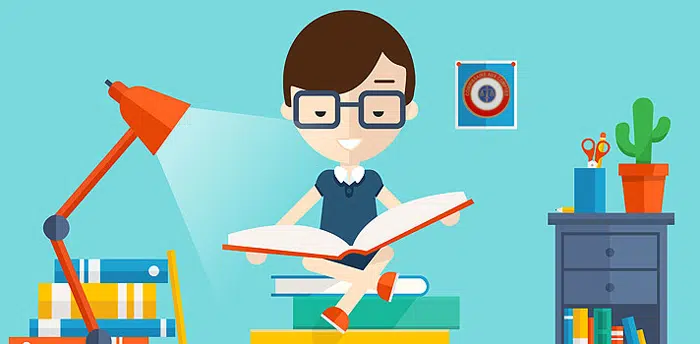En France, la loi recense précisément vingt-six critères de discrimination, tous inscrits dans le Code du travail et le Code pénal. Pourtant, le vingt-sixième critère demeure largement ignoré, bien que son inscription légale soit récente et son champ d’application en pleine évolution.
La reconnaissance officielle de ce critère a redéfini certaines pratiques de sélection et de gestion dans plusieurs secteurs, notamment financier et bancaire. Les acteurs concernés ont dû ajuster leurs procédures pour rester conformes, tandis que les particuliers cherchent à comprendre les implications concrètes de cette évolution réglementaire.
Le critère de discrimination n°26 : de quoi parle-t-on vraiment ?
Le législateur a récemment ouvert un nouveau front : la précarité sociale et la précarité économique. Ce vingt-sixième critère vise expressément les situations où un individu se retrouve désavantagé en raison de sa pauvreté, de son exclusion ou d’une vulnérabilité économique. Ce n’est plus uniquement une affaire de politiques sociales : la sphère bancaire s’en trouve profondément concernée, confrontée à la diversité de ses clients et à l’obligation de traiter chacun équitablement.
En inscrivant ce critère dans la loi, la France engage une lutte affichée contre la stigmatisation et l’inégalité d’accès aux droits. Les établissements bancaires, y compris les banques en ligne, sont sommés de revoir leurs critères de sélection et de gestion. Désormais, refuser l’ouverture d’un compte sous prétexte d’un revenu jugé insuffisant ou d’une situation professionnelle instable tombe sous le coup de la loi. Les axes concrets de cette mutation se dessinent ainsi :
- Précarité sociale : chaque dossier doit être examiné sans préjugé lié à la situation sociale du demandeur
- Précarité économique : il est interdit de priver quelqu’un de services sous ce seul motif
- Accès aux droits : les voies de recours et possibilités de signalement se renforcent pour les personnes concernées
Ce changement transforme le quotidien des usagers bancaires. L’obtention d’un service bancaire de base, d’une carte, ou la réalisation d’opérations courantes, ne peuvent plus être conditionnées à des exigences de revenus jugées arbitraires. Pour se prémunir contre les risques juridiques et d’image, le secteur bancaire ajuste ses pratiques, redéfinissant la relation avec les clients les plus exposés à l’exclusion.
Pourquoi ce critère concerne aussi les néobanques et leurs clients
Ce critère ne cible pas uniquement les banques traditionnelles. Les néobanques, qui misent sur des applications mobiles et une communication vantant l’accès pour tous, se retrouvent elles aussi scrutées. Leur promesse : proposer un service client sans filtre de revenu, d’origine ou de situation professionnelle. Toutefois, l’écart entre discours et réalité apparaît parfois sans détour.
L’automatisation des inscriptions et la gestion des dossiers par algorithmes peuvent entraîner des refus d’accès difficiles à expliquer. Un étudiant, un allocataire du RSA, un intérimaire, confrontés à la procédure d’ouverture chez Revolut, N26 ou Nickel, se voient parfois opposer des critères internes opaques. Le risque de discrimination bancaire ne contourne donc pas ces nouveaux acteurs.
Les offres premium et standard entretiennent une segmentation souvent implicite. Obtenir une carte bancaire physique, accéder à une carte virtuelle ou à des services spécifiques peut reposer sur un scoring difficilement compréhensible. Derrière la promesse d’accessibilité universelle, des limites subsistent, qui frappent en priorité les profils fragilisés.
Les refus restent rares mais réels, souvent liés à un contrôle automatisé d’identité ou de solvabilité.
Une banque en ligne est tenue de garantir un accès égal à ses services, sans distinction abusive. Dès qu’un doute surgit, les clients disposent de la possibilité de signaler toute discrimination supposée auprès d’organismes comme le Défenseur des droits.
La question s’invite jusque dans le fonctionnement même de l’application bancaire : la clarté des critères et la justification des refus deviennent des exigences. La limite entre gestion du risque et exclusion dissimulée est mince. Les néobanques n’ont plus le choix : elles doivent intégrer cette nouvelle donne et replacer la notion d’égalité au cœur de leur modèle.
Comment les offres des néobanques s’adaptent-elles à ce critère ?
Pour répondre aux exigences du critère n°26, les néobanques mettent en avant la diversification des offres. Chacun, de N26 à Revolut, en passant par Nickel, structure ses services autour de plusieurs formules : offre standard, gratuite avec carte virtuelle, versions premium ou metal. L’objectif ? Permettre à tous d’ouvrir un compte, quel que soit leur revenu ou leur situation professionnelle.
En pratique, l’ouverture de compte se fait en quelques clics via une application mobile. La carte virtuelle gratuite devient la première marche. Ensuite, il est possible d’évoluer vers une carte bancaire physique ou des services plus étoffés. Cette logique modulaire s’impose : fonctionnalités comme Apple Pay ou Google Pay, retraits gratuits en zone euro, IBAN français… tout cela est accessible sans considération d’origine sociale.
La question des coûts reste au centre des débats. Les retraits et paiements gratuits dans la zone euro sont devenus le minimum attendu sur les offres de base, tandis que les formules premium ajoutent des services : carte metal, retraits en devises, assistance prioritaire. Mais il subsiste des obstacles : dépôts d’espèces ou chèques sont parfois absents ou payants, ce qui peut exclure certains profils vulnérables.
La transparence tarifaire s’impose peu à peu comme un critère déterminant. Les comparatifs entre banques en ligne révèlent les contrastes selon le canal choisi : application, réseau de partenaires, distributeurs automatiques. Les plus avancés multiplient les moyens de contact avec le service client, que ce soit via chatbot, conseiller humain ou formulaire, sans restriction selon le profil du client.
Échanger et comparer : vos expériences face à la discrimination bancaire
Les témoignages se multiplient. Forums spécialisés ou rapports adressés au Défenseur des droits : chaque histoire dessine les contours mouvants de la discrimination bancaire. Un client Nickel relate le refus d’ouverture d’un compte après avoir présenté un titre de séjour étranger. Une utilisatrice d’une banque en ligne signale la fermeture soudaine de son compte, sans explication malgré un parcours irréprochable. La précarité sociale ou économique agit parfois comme un filtre, même là où l’on promet un accès universel.
Certains obstacles concrets reviennent régulièrement dans les retours d’expérience :
- Délais de traitement plus longs pour certains profils
- Blocages temporaires de comptes jugés atypiques
- Accès restreint à certains services comme le dépôt d’espèces ou de chèques
Comparer les offres devient incontournable : ouvrir un compte chez Boursorama ou Hello Bank ne garantit pas la même expérience qu’avec Nickel ou Revolut. Les avis des clients sur la qualité du service client, la rapidité, la lisibilité des procédures, sont scrutés. Des associations agréées et ONG publient régulièrement des enquêtes, mettant en lumière les progrès ou les dérives du secteur.
La France n’est pas une exception. La stigmatisation liée à l’origine, au statut social ou au niveau de revenus traverse les frontières. Les clients partagent, comparent, alimentent le débat. De ces échanges naît une attente : celle d’un accès aux droits bancaires qui ne soit ni réservé, ni hors d’atteinte. L’équité n’est pas un luxe, c’est une exigence de justice ordinaire.